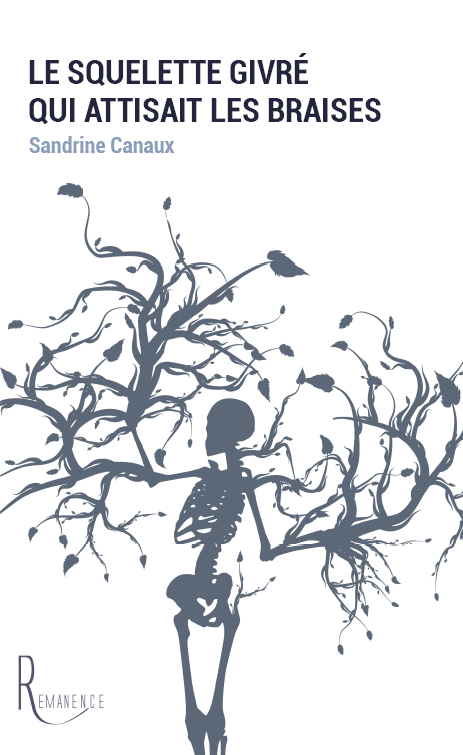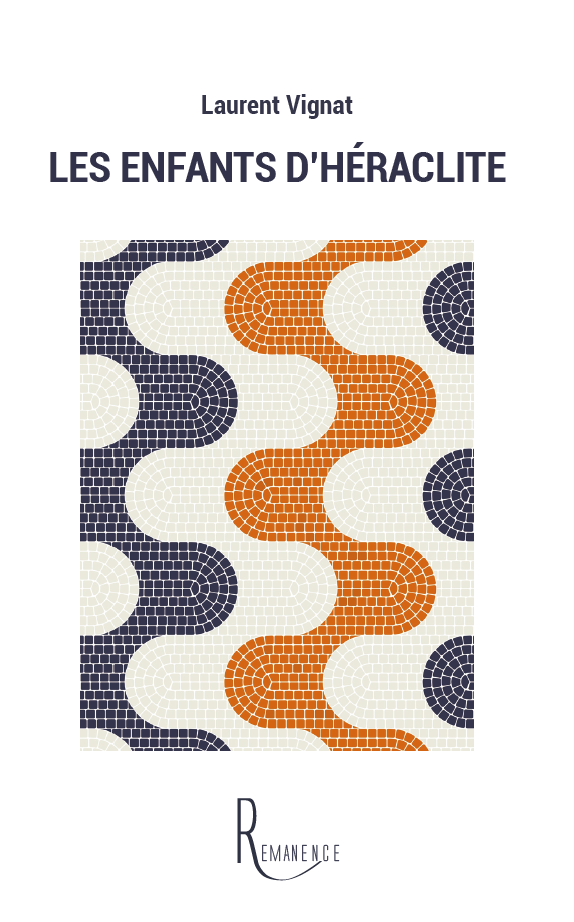Le squelette givré qui attisait les braises
Sandrine Canaux
Ce livre est le journal de retrouvailles invraisemblables intervenues après quarante-cinq ans d’une amnésie profonde. Des retrouvailles avec l’objet perdu de l’amour mais aussi des retrouvailles avec soi-même. Des retrouvailles imposant le renoncement à une identité factice en même temps qu’une réconciliation avec le responsable de traumatismes jusqu’alors ignorés, pour ne pas dire sciemment dissimulés. Il est né du désir d’écrire pour parler de ce qui n’a jamais été dit, pour donner et dire l’amour qui seul guérit nos blessures les plus profondes, et peut-être aussi pour encourager ceux qui le liront à entamer leur propre quête.

Ce que les lecteur en disent...
Du début à la fin ce récit est admirable d’authenticité, d’ouverture de cœur, sans jugement, juste dans une quête de (re)connaissance.
Je recommande vivement ce livre à tous ceux qui se posent des questions identitaires, s'interrogent sur leur constellation familiale, souffrent d'un syndrome d'imposture ou curieux des altérations de personnalité profondes qui s'opèrent lorsqu'on force sa nature pour se conformer.
Quel bonheur de voir les thèmes de l'adoption, la psychogénéalogie, la quête de soi combinés et amenés avec tant de délicatesse et bienveillance ! La plume de l'autrice est une caresse, un nuage de subtilité et de justesse qui vous immerge totalement. J'ai lu ce récit en apnée, enivrée des émotions véhiculées.
Retrouvez d’autres avis des lecteurs sur Babelio.fr.

Extraits
On en parle
À propos de l'auteur

Sandrine Canaux
Sandrine Canaux a vécu son enfance et son adolescence à l’étranger. De cette période, elle a gardé le goût des